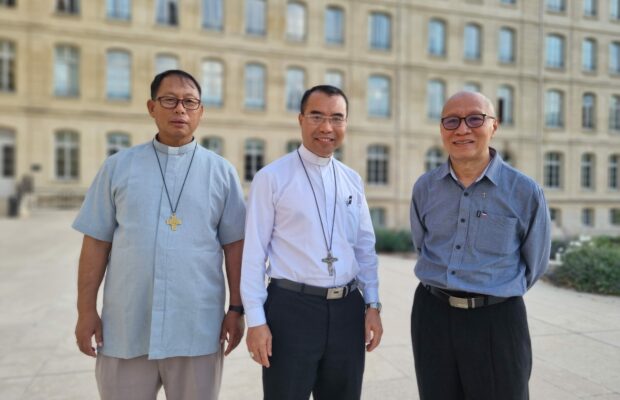Enfants du Mékong soutient l’initiative du Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR) et du Bangkok Refugee Center (BRC) pour venir en aide aux familles demandeuses d’asile dans la capitale. À ce jour, le programme compte 36 écoliers dont la demande de statut de réfugié est en cours ou a été refusée. En complément de l’accompagnement et de l’aide que fournit le BRC à chacun, Enfants du Mékong se focalise sur le soutien financier pour l’éducation des enfants.
Saehai a 13 ans. Avec ses parents, sa petite-sœur Tiswa, 11 ans, et son petit frère Siphon, 7 ans, ils sont arrivés en Thaïlande il y a 6 ans. Originaires de Đà Lạt au Vietnam, ils ont fui les répressions et persécutions du gouvernement en raison de leur appartenance au groupe ethnique minoritaire Hmong et de leur christianisme. Arrivés légalement en Thaïlande, leur titre de séjour a depuis longtemps expiré.
La famille loue une habitation de deux pièces dans un quartier de Bangkok. Le père et la mère sont travailleurs journaliers, respectivement dans des chantiers de construction et une usine de confection de vêtements. Sans permis de travail, ils subissent des conditions de travail et des salaires déplorables.
« Nous vivons constamment dans la peur de tomber sur la police. C’est difficile à vivre », nous confie Saehai. Dernièrement, son père y a été confronté et a dû payer un pot-de-vin pour éviter d’être envoyé en centre de détention. « Les autorités font des arrestations régulières dans les rues des quartiers où les réfugiés et clandestins sont susceptibles de se trouver. Beaucoup n’ont pas du tout les moyens de payer les pots-de-vin souvent exigés et sont envoyés dans des centres surpeuplés et insalubres où les conditions de vie sont extrêmes », informe Diramedhist Lueng-Ubon, superviseur du département éducation au sein du BRC.
Malgré ces difficultés, Saehai se sent plus Thaïlandais que Vietnamien. Son rêve est de devenir chef cuisinier au Canada. Saehai, son frère et sa sœur ont la chance d’aller à l’école primaire gouvernementale où ils sont bien acceptés par les professeurs, moins par certains camarades.